
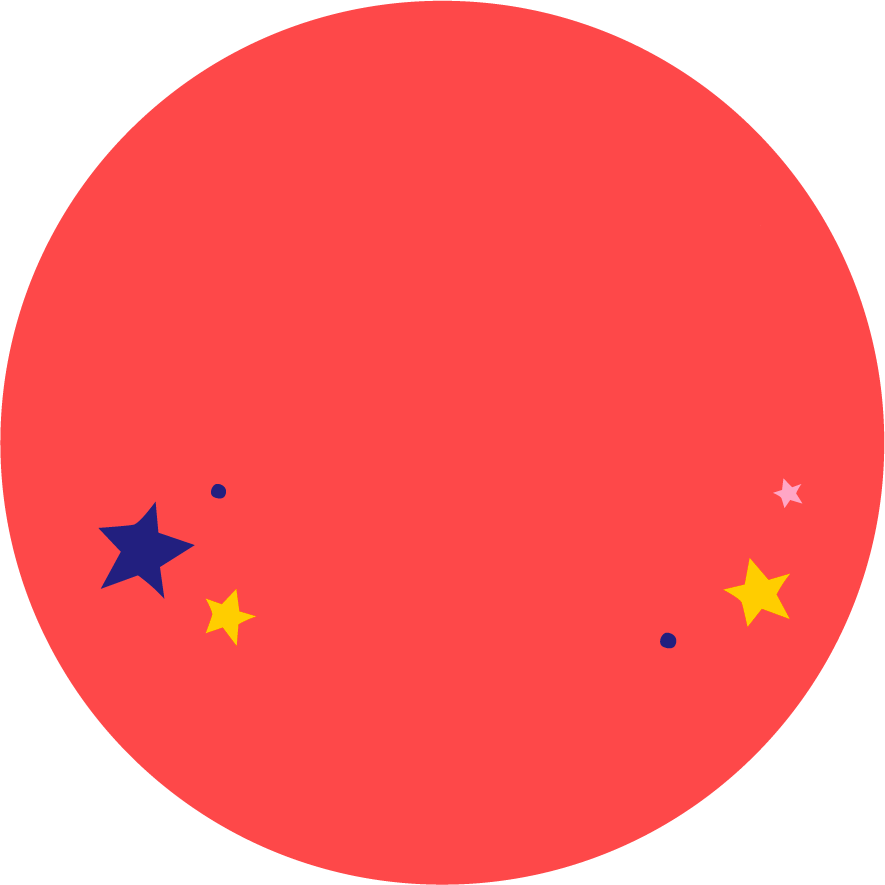
Difficile de faire sa place lorsqu’on déménage dans un quartier où la loi du plus fort règne parmi les enfants.
Keiji et Ryoichi, deux jeunes frères épris de liberté, résistent avec malice et fraternité, et finissent par se faire respecter dans ces terrains vagues où les trains filent en aveugle entre les routes toutes tracées d’un avenir incertain.
Mais leur père, ce chêne inflexible qui leur impose de ne plus faire l’école buissonnière, s’avère être un roseau plié aux sarcasmes à peine voilés de son patron. Le fragile équilibre rompt alors et l’orage éclate : les deux enfants s’opposent crûment à leur père, dont ils ne peuvent supporter l’asservissement, fût-ce pour les nourrir. Devant cette injustice que les grands ingurgitent avec résignation, ils décident eux, du haut de leur enfance, de ne plus jamais manger.
C’est sans compter sur la force d’amour de leurs parents.
Au père qui demande à ses fils si leur nouvelle école leur plaît, le cadet lance tout-de-go, avec la belle sincérité de son âge : « on aime bien le chemin de l’école et le chemin du retour. Mais on n’aime pas la période entre les deux ». « La période entre les deux », c’est ce à quoi nous intéresse Y. Ozu : cette frontière entre leurs escapades à l’air libre, et l’école où personne ne peut sortir de la place étriquée qui lui est assignée.
Mais c’est aussi tout cet « entre-deux » dont les deux frères font l’apprentissage : l’équilibre à trouver entre la cruauté des petits et la hiérarchie dédaigneuse des plus grands, entre la franchise de l’enfance et l’hypocrisie des adultes, entre un père que l’on voudrait fort pour s’y mirer et un père soumis, dont les compromissions n’offrent aucun espoir de grandir dans une société plus juste, entre le pouvoir de l’argent et celui de l’intelligence. Difficile de concilier les deux, et Ozu suit pas à pas cette mise à l’épreuve en filmant, avec une apparente impassibilité, leur quotidien à hauteur d’enfant.
Sa caméra, qu’il ne cessera ensuite de poser toujours plus bas, presque au ras du tatami, cadre au millimètre la chorégraphie subtile des déplacements de chacun et les petits détails qui brisent la bienséance : barrières qui scandent le passage du train, ombres qui s’éclipsent derrière les cloisons de papier, taches sur un veston qui trahit tout ce qu’on veut cacher, ou « tache » des grimaces du père qui, sur l’écran blanc d’une séance de cinéma, nourrissent la honte des fils. En suivant la traversée de ces frontières fragiles, Ozu passe librement de la comédie au drame et met à nu, avec une profonde humanité, la complexité des sentiments des enfants. Leur jeu très épuré et la vivacité de leurs regards, qui tranchent de façon moderne avec les mimiques faciles qu’un film muet burlesque pourrait solliciter, nous transmettent ainsi immédiatement leur joie, leur violence, leur désarroi ou leur malice.
Pas besoin d’être féru du Japon ou d’histoire du cinéma pour apprécier. Ce film s’adresse à tous, directement, au delà des frontières géographiques ou temporelles, en traitant de questions essentielles dans la vie d’un être humain : comment grandir ? Comment résister à une injustice ? Comment trouver sa place dans le monde ? Qu’est-ce qui se transmet d’un parent à un enfant ?… Et qu’est-ce qu’un père ?
Gosses de Tokyo est un des plus célèbres films muets de Y. Ozu, qui n’envisagera de tourner un film sonore qu’à partir de 1936, et un film en couleurs qu’en 1958, sous la pression de la grande société de production Shōchiku. C’est que, pour Ozu, l’intervention des progrès technologiques ne rime pas forcément avec progrès dans les relations humaines ou dans l’expression des sentiments. L’essentiel est ailleurs, et sa modernité rayonne encore aujourd’hui à travers une mise en scène épurée et un jeu d’acteurs délesté de toute théâtralité. Sa modernité éblouit autant le public français, qui ne découvre son œuvre qu’à la fin des années 70, qu’une multitude de réalisateurs : de l‘Américain Paul Schrader à l’Allemand Wim Wenders, du Finlandais Aki Kaurismäki à la Française Claire Denis, ou encore du Portuguais Pedro Costa à l’Iranien Abbas Kiarostami, en passant par le Taiwanais Hou Hsiao-Hsien et bien d’autres. Gosses de Tokyo est aussi le 24e long métrage d’une impressionnante série de 54 films qu’Ozu tournera jusqu’en 1962, un an avant sa mort à l’âge de 60 ans. Il en tournera un remake en couleurs en 1959 : Bonjour, qui réactualise le parcours initiatique du quotidien des deux frères. Leur révolte prend là une autre forme : ils décident de s’arrêter de parler, tout simplement pour avoir une télévision.
L’enjeu est apparemment moins tranchant que la remise en cause d’un père et des inégalités de classe, mais tout aussi pointu sur les difficultés de communication au sein d’une famille. Bonjour, filmé avec un tempo, un sens du cadre et de la couleur toujours plus maîtrisés, révèle autant de légèreté rieuse que de grincements : Ozu n’hésite pas à briser son image de respectabilité en développant par exemple toute une série de farces liées à la question aérophagique, grand sujet de rires chez les enfants s’il en est, qu’il relie à la valeur d’un père… et d’une mère qui croit, dans ces moments, que son mari l’appelle.
Parler, se dire ou non les choses, transmettre ou non le meilleur à son enfant, cacher ou non certaines réalités à son parent, voilà qui ne cessera de questionner Y. Ozu tout au long de ses films. En ce sens Le fils unique, son premier film parlant, pourrait finalement être la suite directe de Gosses de Tokyo : un fils de 9 ans que l’on suit de son village jusqu’à la ville, adulte et marié. Le lien aux parents structure là aussi toute sa vie : une mère trop présente par le poids du sacrifice que représente pour elle, simple fileuse de soie, le paiement des études de son fils qui n’arrive pas à être à la hauteur. Et en creux, dans ces espaces vides qu’Ozu aime tant filmer, un père totalement absent, trop absent, pour l’aider à lutter dans ce Japon des années 30 où les injustices sociales maintiennent de nombreux lettrés dans la misère.
Cet absence, Ozu, fils cadet d’un riche marchand d’engrais, la connaissait bien : son père, désireux que ses enfants s’épanouissent à la campagne, avait confié les cinq enfants à leur mère en province tandis que lui demeurait à Tokyo pour son commerce. Ozu passera donc toute son enfance sans lui.
Sur la vie et l’œuvre d’Ozu :
http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-yasujiro-ozu-1903-1963-2013-03-09
Sur le cinéma muet au Japon et les premiers… Benshis :
http://www.cinemasie.com/fr/fiche/dossier/211/
http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/video/video-yasujiro-ozu-art-benshi
Claire Denis à propos de Yasujiro Ozu :
https://www.youtube.com/watch?v=wPIo6Civtok
Textes :
Carnets 1933-1963, par Yasujiro Ozu lui même. (Éd. Alive, 1996)
Introduction à Yasujiro Ozu , (Éd. Festival international du film de Locarno, 1979)
texte de R. Barthes sur le Japon, et entretiens de réalisateurs, critiques et collaborateurs d’Ozu.
À partir de 7 ans. Gosses de Tokyo s’adresse tout autant aux enfants qu’aux adultes. Les plus jeunes riront avec ces enfants rusés jamais à court de blagues et seront captivés par la force de leur courage face à l’adversité. Les adultes apprécieront la justesse des sentiments que chaque personnage éprouve, et la beauté incomparable de la composition graphique de ce film en noir et blanc. Tous aimeront le face à face très cruel entre ce père et ses enfants, qui ne manquera pas d’ouvrir de vifs débats en famille après la vision du film !